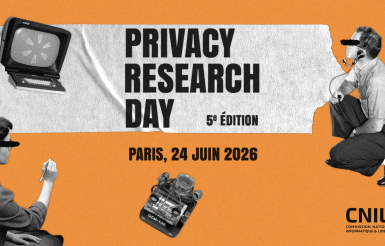[Article 1/2] Les neurotechnologies, à la conquête du cerveau
Rédigé par Régis Chatellier
-
01 octobre 2025Le cerveau et le système nerveux se sont mués en un nouvel espace de conquête pour celles que l’on nomme les « neurotechnologies ». D’abord cantonné au secteur médical, des applications se développent dans une grande variété de secteurs d’activité relevant du secteur privé, ou à visées commerciales. Cet article propose une définition de ces neurotechnologies ainsi qu’un panorama des typologies et contextes d’usages pour les « neurodonnées ».

L’étude et la compréhension du cerveau ont depuis toujours fasciné l’humanité, depuis les premiers traités de médecine aux différentes croyances développés au sein des sociétés humaines. Les neurosciences ont vu émerger depuis une cinquantaine d’année un nouveau champ : les « neurotechnologies », qui visent à comprendre et à produire des actions sur le cerveau et le système nerveux. Ces neurotechnologies agissent sur la base de données personnelles, collectées directement sur le corps humain.
D’abord réservé au secteur de la santé, à la réparation des corps et des esprits, les avancées technologiques dans ce domaine sont de plus en plus mises au service de finalités aussi variées que les loisirs, l’éducation, le commerce, etc. Elles s’inscrivent dans une histoire longue des rapports de l’humain à sa propre finitude, et à la volonté de réunir humains et machines, à l’œuvre dans la cybernétique ainsi que dans le transhumanisme. Comme le pointe David Le Breton (L’Adieu au corps, 1997, p.185), Norbert Wiener, en 1948 dans son ouvrage Cybernetics, « est sans doute le premier à brouiller les frontières de l’automate et du vivant », « La suppression de tout obstacle entre l'ordinateur et soi amène certains au désir de symbiose avec la machine ou au rapprochement avec elle sous la forme rêvée d'une incorporation cérébrale de puces ». Du point de vue des personnes qui souhaitent avoir recours à ces technologies, il ne s’agirait plus de guérir, mais de s’interfacer, voire de s’augmenter. Plus simplement, du point de vue des promoteurs et entreprises qui développe ces technologies, il peut s’agir d’améliorer l’expérience, faciliter l’enseignement et l’éducation, ou parfois vendre plus facilement certains produits.
Santé, premier terrain d’expérimentation
Historiquement, le champ de la santé est celui où se sont développées les recherches et les premières expérimentations, dans une cadre très encadré.
Le traitement de l’épilepsie a notamment fait l’objet de recherches dès les années 50, jusqu’à aboutir au développement d’implants « invasifs », pour la neurostimulation. En 1997, par exemple, la US Food and Drugs Administration (FDA) autorise la mise sur le marché de dispositifs implantables tels que le « système de stimulation cérébrale profonde (DBS) » pour le traitement des tremblements et le « stimulateur du nerf vague » pour l'épilepsie réfractaire au traitement médicamenteux. L’entreprise Medtronic propose également des dispositifs de stimulation cérébrale profonde, pour le traitement de l’épilepsie, ou de la maladie de Parkinson. Des implants peuvent également viser à restaurer ou améliorer l’audition, à permettre à des personnes de retrouver l’usage de leurs membres, à l’exemple de cette approche développée par des scientifiques du centre Neurorestore (EPFL/CHUV/UNIL), « qui combine la robotique de rééducation et la stimulation spinale pour rétablir le mouvement chez les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière ».
En parallèle de ces initiatives, les neurotechnologies attirent des dirigeants d’entreprises de la Silicon Valley, à l’image d’Elon Musk. Dès 2016, il cofonde Neuralink, « avec comme objectif la recherche et le développement d'implants cérébraux de type Interface neuronale directe implantables chez des patients dont le cerveau a été lésé (Wikipedia) ». Neuralink a obtenu en 2023 l’autorisation de tester sur des êtres humains sont implant neuronal. En janvier 2024, elle annonçait avoir implanté son système sur un premier patient atteint de tétraplégie. L’entreprise, cependant, continue à soulever des questions quant aux résultats effectifs de ses dispositifs. En février 2025, vingt employés de la FDA qui pouvaient être amenés à évaluer Neuralink étaient licenciés par le DOGE, le Département de l'efficacité gouvernementale dirigé alors par Elon Musk. En août 2025, Sam Altman, le PDG d’openAI se lance dans la course aux neurotechnologies pour financer Merge Labs, une startup dont l’objectif sera de connecter cerveaux humains et ordinateurs au moyen des systèmes d’intelligence artificielle. Une pierre lancée dans le jardin d’Elon Musk avec qui il entretient des relations de rivalités, mais aussi un projet plus ancien. Dès 2017, il détaillait sa vision du concept de « The Merge » dans un billet de blog : « La fusion (The Merge ») peut prendre de nombreuses formes : nous pourrions brancher des électrodes sur notre cerveau, ou nous pourrions tous simplement devenir des amis très proches d'un chatbot. »
Dans ce premier article, nous revenons sur ce que sont les neurotechnologies, leur définition, les différentes formes et modalités d’action qu’elles recoupent, ainsi que des nouveaux usages et secteurs d’activités.
[Le cyborg], ce n'est pas seulement Robocop, c'est notre grand-mère avec un pace-maker.
Qu’entend-on par neurotechnologies ?
Dans un document publié en 2022, The Risks and Challenges of Neurotechnologies for Human Rights, le Conseil scientifique consultatif des Nations-Unies définit les neurotechnologies comme « un terme générique désignant l’ensemble des technologies qui enregistrent ou modifient l’activité des neurones du système nerveux humain ». L’OCDE en 2019, dans sa recommandation sur l’innovation responsable dans le domaine des neurotechnologies, les décrivaient comme des « dispositifs et procédures utilisés pour accéder au fonctionnement ou à la structure des systèmes neuronaux de personnes naturelles et de l’étudier, de l’évaluer, de le modéliser, d’exercer une surveillance ou d’intervenir sur son activité ». Les données collectées par ces dispositifs - neurodonnées, neurodata, ou « données neurales » - concernent en premier lieu les données collectées directement à partir des systèmes neuronaux d’une personne, qu’il s’agisse du cerveau ou du système nerveux, mais aussi des données déduites et inférées à partir de celles-ci.
Dans un rapport publié en 2024, le Comité consultatif du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU pointe qu’en établissant une passerelle et une connexion directe entre le cerveau humain et des dispositifs externes, les neurotechnologies dotent des acteurs externes « de la capacité inédite d’influer sur la jouissance des droits d’un individu », ce qui soulève « d’énormes problèmes éthiques et remet en question l’interprétation même des principes fondamentaux des droits de l’homme ». Ceci dans un contexte ou le secteur d’activités connait des avancées importantes ces dernières années favorisées par des développement technologiques importants, du point de vue des dispositifs, mais aussi des capacités de calcul et du développement des systèmes d’intelligence artificielle.
Une typologie de formes et d’actions
Les dispositifs et les moyens par lesquels la collecte de ces données peut être effectuée peuvent varier selon leurs modalités, leurs objectifs, la manière dont les personnes concernées les perçoivent et leurs interactions. Ceci donne lieu à une typologie des critères suivant trois modalités d’action, d’abord la manière et les dispositifs à partir desquels sont collectées les données, depuis des implants jusqu’à la collecte à distance. Ensuite, l’objectif des technologies mises en œuvre, qu’il s’agisse de lire et comprendre le cerveau, d’agir sur celui-ci, ou de l’interfacer avec des systèmes. Enfin, selon que les personnes concernées soient actrices de cette collecte, ou qu’elles soient passives.
Différentes formes de capteurs et stimulateurs
Les neurotechnologies, pour fonctionner, doivent déployer des capteurs ou des stimulateurs pour se connecter au corps et au cerveau. Ces dispositifs peuvent prendre trois formes : invasifs, semi-invasifs ou non invasifs :
- Invasifs : il s’agit ici d’avoir recours à des dispositifs implantés directement sur le cerveau de la personne, nécessitant une intervention chirurgicale crânienne. Ce type de solution permet de collecter des données très précises, où d’agir directement sur le système nerveux. Par leur caractère invasif, ils peuvent poser des risques inhérents à toute intervention chirurgicale, d’infection, de rejet, de cicatrisation. Il peut s’agir d’électrodes intracorticales, implantées dans le cortex pour enregistrer ou stimuler les neurones individuellement (utilisées par exemples par Neuralink), d’Électrocorticographie (ECoG), soit une grille d’électrode posée directement sur la surface corticale (sous la dure-mère, membrane qui entoure le cerveau), ou de stimulateurs cérébraux profonds (DBS), des électrodes implantées dans des noyaux profonds (ex. noyau subthalamique pour la maladie de Parkinson).
- Semi-invasifs : il s’agit ici de dispositif épidural, ou sous-dural, placé à proximité du cortex, par exemple l’électrocorticographie épidurale ou sous-dural légère, des électrodes posées sur la dure-mère, donc pas en contact direct avec les neurones, ou des Stentrodes (Stentrode BCI), des électrodes introduites dans les vaisseaux sanguins cérébraux (via un cathéter), permettant d’enregistrer l’activité sans ouvrir le crâne.
- Non-invasifs : ces dispositifs sont placés sur ou à distance du corps, par exemple sous forme de bandeau, de patch, sur des lunettes connectées, ils permettent de collecter des données sans comporter de risques associés à la chirurgie. Par exemple les électroencéphalogrammes (EEG), l’imagerie à résonance magnétique (IRM), l’imagerie à résonance magnétique fonctionnelle (IRMF), ou la stimulation transcrânienne (TeS), par des champs magnétiques ou courants électriques appliqués sur le cuir chevelu. Développé d’abord pour la médecine, ce type de dispositif donne lieu à des expérimentations en dehors du champ médical, dès lors que leur usage est facilité et sans risque direct pour la santé.
Parmi les dispositifs, non invasifs, l’EDPS différencie dans son Tech Dispatch ceux qui agissent « en local », dont les capteurs placés au contact de la personne lui permettent d’avoir connaissance de la collecte de donnée, des dispositifs « à distance », dont les capteurs ne sont pas au contact de la personne. Dans ce dernier cas, la collecte peut être invisible pour la personne. Le LINC avait repéré dès 2016 le cas d’un capteur d’émotion à distance développé par le MIT, qui mesurait l’activité du cœur pour inférer des états émotionnels.
Différentes modalités d’action
Les neurotechnologies peuvent avoir pour objectif d’agir de plusieurs manières : « en lecture », « en écriture » sur le cerveau, ou en tant qu’interfaces :
- En lecture, ou en « neuroimagerie », il s’agit de surveiller la structure et le fonctionnement cérébral. Il peut s’agir par exemple d’électroencéphalogramme (EEG), ou d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), ou tout autre type de capteur dès lors qu’il collecte des données neurales. La collecte de données peut être « active », la personne doit effectuer des tâches spécifiques tels que des mouvements, des calculs, lire, regarder une vidéo ou écouter certains sons comme de la musique, qui vont donner lieu à un enregistrement de la réponse aux actions ou stimuli. Elle peut aussi être « passive », sans que la personne n’ait à effectuer d’action en particulier. Il peut s’agir d’un enregistrement sur une plus longue durée, par exemple, visant à mesurer le niveau de fatigue, la capacité d’attention ou le niveau d’excitation.
- En écriture, il s’agit non plus de collecter ou capter des données, mais de stimuler le cerveau par l’envoi de signaux, électrique, magnétique ou ultrasons, pour influencer certaines de ses fonctions. Il est possible de distinguer la neurostimulation (produisant des effets directs, à court terme), soit “appuyer sur un bouton” pour activer/désactiver une fonction, par exemple agir sur le tremblement dans une maladie de Parkinson, ou agir sur des nerfs ou des muscles périphériques pour restaurer le mouvement chez des patients paralysés ; et la neuromodulation (visant à modifier la manière dont fonctionne le cerveau, à long terme), par exemple la stimulation du nerf vague (Neuromodulation vagale) pour traiter l’épilepsie, ou la dépression. Certains systèmes agissent en boucle fermée (closed‑loop) et s’adaptent en temps réel selon l’activité détectée (en lecture) sans que les données ne soient envoyées sur un serveur extérieur.
- En interface : dans un troisième cas d’usage, tel que décrit par le Conseil scientifique consultatif des Nations-Unies, les neurotechnologies consistent en des « Interface cerveau-ordinateur » (Brain-Computer Interface - BCI) ou « interface cerveau-machine » (Brain-Machine Interface - BMI). Il précise que « l’interface cerveau-machine a tendance à faire référence à des machines implantées directement sur des humains tandis que l’interface cerveau-ordinateur peut également couvrir des technologies non-invasives. »
Le champ des neurotechnologies recoupe on le voit une grande diversité de formes et modalités, qui chacune représente une série de défis pour les autorités de protection des données, dès lors qu’elles ont pour objet de collecter et de traiter (notamment d’altérer) des données personnelles parfois inexprimées. Ceci dans un contexte où comme nous le voyons ci-dessous, le champ des recherches, des expérimentations et des cas d’usages tend à se développer assez largement au-delà du seul champ médical, avec des risques associés pour les droits des personnes concernées.
Vers une extension des champs d’application et cas d’usages
Les champs d’application se sont récemment élargis, pour des finalités d’usages qu’il est possible de reclasser dans les trois catégories citées plus haut : lecture, écriture, interface. Ces développements sont à situer dans un contexte où le marché des neurotechnologies est en pleine expansion et devrait croître de 21 milliards de dollars en 2026, au point qu’il pourrait intégrer assez rapidement nos vies quotidiennes.
Lecture : comprendre, analyser, prévoir le cerveau
Les applications visant à lire et comprendre le cerveau se sont largement développés dans des secteurs aussi variés que l'éducation, le divertissement, l’économie et le marketing, le travail, ainsi que la sécurité et la surveillance. Il s’agit ici de collecter des données du cerveau et du système nerveux par des dispositifs dédiés, afin de mesurer l’activité et d’inférer des analyses et résultats en fonction de l’objectif poursuivi. De plus en plus, ces dispositifs sont associés à des systèmes d'intelligence artificielle.
Pour améliorer les capacités, l’expérience
Dans le champ de l’éducation, les neurotechnologies sont testées à des fins d’amélioration des performances et des résultats d’apprentissage. Le Guardian recensait notamment en 2019 le cas d’une école primaire en Chine où des bandeaux dotés de capteurs similaires à des électrodes d’électroencéphalogramme (EEG) étaient utilisés pour mesurer l’activité cérébrale des élèves lors de certains exercices. Ceci s’inscrit dans les méthodes associées au Learning Analytics, que le LINC avait exploré dans un article en 2017.
Dans les jeux vidéo, les neurodonnées peuvent être utilisées afin de maximiser l’expérience des joueurs et joueuses, afin que le jeu s’adapte aux réactions et comportement, pour renforcer le plaisir de jouer. Le LINC avait exploré de tels usages dès 2015 dans son cahier IP4, sur les industries créatives. Dans une revue de littérature publiée en 2025, des chercheurs listent différentes applications possibles à partir d'interfaces cerveau-machine, permettant la modélisation de la réponse à des stimulations visuelles de manière non invasive (Visual Evoked Potential - VEP), pour l'acquisition et le traitement des signaux électroencéphalographiques (EEG). Il serait possible d'améliorer l'accessibilité pour les joueurs souffrant de handicaps physiques ou cognitifs, de prendre en charge l'adaptation de la difficulté et la personnalisation de la manière dont la partie se joue (« gameplay »), les interactions multijoueurs, etc. Les auteurs précisent cependant que des défis restent relever, du fait notamment des limites techniques de ces systèmes, de la complexité d’interprétation des données, et de l’adaptabilité des utilisateurs. Dans le prolongement des jeux vidéo, les métavers et plus largement les interfaces immersives ont suscité de nombreux questionnement quant à la sensibilité et la granularité des données potentiellement connectées par les casques de réalité virtuelle.
Pour anticiper les comportements
Dans les entreprises, les neurotechnologies peuvent être employées à des fins de suivi des employés, pour améliorer leurs performances, pour le recrutement ou la promotion de salariés. Dès 2011, Raja Parasunaram décrit le nouveau champ de la neuroergonomie, soit l’étude du cerveau humain en relation avec les performances au travail et dans la vie quotidienne, à partir de théories et de principes issus de l’ergonomie et des neurosciences. La neuroergonomie a plusieurs cas d’usage, elle peut notamment viser à surveiller les employés pendant qu'ils apprennent de nouvelles tâches, afin de déterminer quand ils les maîtrisent. Elle permettrait également de mesurer en temps réel la fatigue des employés occupant certains postes qui exigent une vigilance optimale, et déterminer quand ils ont besoin d'être remplacés. A titre d’exemple, en 2018 en Chine, « des ouvriers, des militaires et des conducteurs de trains était équipés de casques ou casquettes munis de capteurs afin de mesurer le niveau de stress au travail, pour, par exemple, adapter le rythme de production ». Dans l’aviation, des recherches sont menées afin de mesurer la charge mentale des pilotes à l’aide de techniques d’apprentissage automatiques, sur des données d'électroencéphalogramme (EEG), dans un contexte où l’augmentation ou la diminution de la charge mentale peut altérer l'attention auditive et visuelle, entraînant des erreurs de pilotage. Les neurotechnologies sont par ailleurs utilisées pour le recrutement ou pour mesurer la productivité des employés.
Dans le champ de la sécurité et de la justice, le plus ancien et le plus connu des cas d’usage reste le détecteur de mensonge. Mais il est possible de recenser de nombreuses initiatives d’estimation du risque de récidive du crime : plus d’une soixantaine aux Etats-Unis en 2020 selon la chercheuse Angèle Christin. Certains auteurs prédisent que l’usage des neurotechnologies pourrait améliorer l’efficience de ces systèmes prédictifs dans un futur proche, et permettre ainsi de « libérer plus tôt des prisonniers qui ne seraient plus à risques ». Ils rappellent néanmoins les risques pour l’autonomie, l’intégrité mentale et la protection des données des prisonniers qui devraient se soumettre à ces neurotechnologies.
Pour maximiser les ventes
Les secteurs de l’économie et du marketing ont investi les neurotechnologies depuis plusieurs décennies. Le terme neuroéconomie apparaît dès 2003 dans l’ouvrage de Paul W. Glimcher, Decisions, Uncertainty, and the Brain: The Science of Neuroeconomics (Décisions, incertitude et cerveau : la science de la neuroéconomie). Cette branche de recherche se situe au croisement de l’économie et des neurosciences cognitives, elle vise à étudier l’influence des facteurs émotifs et émotionnels dans les prises de décisions d’achat, d’investissement, etc. Le neuromarketing, terme utilisé pour la première fois en 2002, s’intéresse plus spécifiquement à prédire les choix et les goûts des consommateurs, sur la base de l’analyse des mécanismes cérébraux et des zones activées ou désactivées lors d’un acte d’achat, ou lorsque les personnes sont face à une publicité, un emballage, etc. L’objectif poursuivi consiste à produire des outils de persuasion du consommateur, à la réduction de l’incertitude et à la prédiction des comportements et prises de décisions.
Jusqu’à présent, il s’agit le plus souvent d’analyses effectuées sur des échantillons de personnes sur la base du suivi du regard (eye-tracking) et de la collecte de neurodonnées pour tester ou améliorer certains produits ou services, le plus souvent en laboratoire. En général, il s’agit de classification binaire « j’aime » ou « je n’aime pas » en utilisant des électroencéphalogrammes. Avec le développement de nouvelles interfaces, comme le note l’ICO, des appareils non invasifs pourraient à l’avenir être « capables de lire les réactions pourraient être utilisés à domicile pour adapter les produits aux préférences des consommateurs. Il pourrait s'agir de casques audios équipés de dispositifs qui cibleraient la publicité et les messages commerciaux pour divers produits, à l'instar du suivi en ligne à l'aide de cookies. Cela pourrait être utilisé pour générer de nouvelles réponses personnalisées en fonction de l'utilisation des moteurs de recherche par les utilisateurs. » Ces technologies pourraient également être intégrées, comme nous le notions en 2022, à des dispositifs de réalité virtuelle.
Le neuromarketing a depuis ses débuts fait débat, notamment parce qu’il s’agit de manipuler les comportements des consommateurs à leur insu, par des mécanismes dont ils n’ont pas conscience. Il est possible d’établir un parallèle avec les mécanismes à l’œuvre dans l’économie de l’attention, notamment au travers des dark patterns, dont les finalités se recoupent. Le traitement et la manipulation de données issues des neurotechnologies vient renforcer ici les questions éthiques et juridiques.
Interface : contrôler une application ou un appareil
Dans cette deuxième typologie de cas d’usage, les données collectées par des interface humain-machine sont traitées afin de produire en retour une action sur un objet, un logiciel, etc. Il ne s’agit plus de contrôler un dispositif par une interface homme-machine traditionnelle – un clavier, une souris, ou même la voix –, mais directement par le système nerveux, ou « la pensée ».
Ce type d’interface est utilisée dans le domaine de la santé pour le contrôle de systèmes d’aide orthopédiques, de prothèses, ou d’implants médicaux. Il peut s’agir par exemple d’un implant cérébral « qui décode l’intention de l’utilisateur et la transforme en signal à un bras robotique », donnant de l’autonomie à des personnes tétraplégiques, ou de la mise au point en 2024 par le Massachusetts institute of technology (MIT) de Boston, aux Etats-Unis, de la première « jambe bionique » entièrement contrôlée par le cerveau. Grâce à celle-ci, « sept personnes amputées d'une jambe ont ainsi pu remarcher de manière quasi naturelle, sans pensée consciente. »
En France, l’équipe de recherche Hybrid, basée à Rennes s’est spécialisée depuis 2013 dans les interactions 3D et les environnements virtuels utilisant le corps et l’esprit, et développe des systèmes d’interactions contrôlées par l’esprit (mind-based control). Dès 2013, elle a conçu la plateforme logicielle OpenViBE, utilisée aujourd'hui dans le monde entier, pour développer des applications d’interfaces cerveau-machine, compatible avec de nombreux dispositifs d’électroencéphalogramme. Ces interfaces peuvent trouver des applications dans les jeux vidéo, la réalité virtuelle, pour contrôler des jeux ou certains logiciels. Il peut s’agir également de contrôler des machines, ou des applications dans le secteur de la robotique, voire, dans le secteur de la défense, de contrôler des armes, des robots de déminages, des véhicules ou des drones.
Des systèmes destinés au grand public arrivent sur le marché. Meta investit dans des interfaces basées sur les données du système nerveux, avec son bracelet EMG. Ce dispositif utilise, selon le site de Meta, l’électromyographie, qui « mesure l’activité du signal électrique envoyé par le cerveau aux muscles du poignet lorsque des gestes sont effectués en portant le bracelet. Il s’agit de détecter des signaux basés sur l’action que l’utilisateur a l’intention de réaliser, par exemple, cliquer, sélectionner ou faire défiler. Le bracelet permet déjà de contrôler des applications, ou de jouer à des jeux vidéo simples. Meta prévoit à l’automne 2025 de les associer à des lunettes de réalité augmentée.
Ecriture : neurostimuler et/ou neuromoduler le cerveau
Le troisième grand type d’usage vise non plus seulement à collecter pour lire et interpréter les neurodonnées, mais à agir « en écriture » par des boucles de rétroaction et l’envoi de signaux pour modifier la manière dont fonctionne le cerveau ou le système nerveux. Il est possible de distinguer la neurostimulation qui visent à produire des réactions au message envoyé, de la neuromodulation, dont l’action s’inscrit sur un plus long terme, pour modifier la manière dont le cerveau fonctionne (pour guérir ou pour améliorer).
Comme le précisent l’EDPS et l’AEPD, il peut s’agir en psychologie du traitement de neurodonnées pour modifier la façon dont le cerveau réagit à certains stimuli à des fins thérapeutiques, en surveillant l'activité cérébrale et en fournissant un retour d'information, généralement sous forme de signaux visuels ou auditifs. Ce type de traitement peut notamment être utilisé pour le traitement des troubles de l’attention, l'anxiété, la dépression, l'épilepsie, les troubles du spectre autistique, l'insomnie ou la toxicomanie.
Le traitement des données neurologiques peut également être utilisé pour améliorer les capacités d’attention ou concentration, cognitives et affectives chez des personnes en bonne santé. Il s’agit ici d’entrainer le cerveau pour viser la « neuro-amélioration », et obtenir des bénéfices allant au-delà du fonctionnement normal d’un cerveau moyen. Bien que l’efficacité de ces systèmes chez des adultes en bonne santé ne soient pas encore démontrée, il est possible de retrouver des applications sur le marché. Des joueurs de football américain, des basketteurs, mais aussi des militaires, par exemple, ont recours à la solution NeuroTracker, pour « aiguiser leurs réflexes, améliorer leur champ de vision sur le terrain, et réfléchir plus vite sous pression ».
* * *
Ces nouveaux développements des neurotechnologies, et leur sortie du champ médical, très régulé, pour aller vers le secteur privé et des usages commerciaux contribuent à renforcer les préoccupations quant aux conséquences possibles de mésusages des neurotechnologies. Le statut de ces données du point de vue de la protection des données personnelle soulève certaines questions notamment. Plus largement, c’est l’encadrement de ces pratiques d’un point de vue éthique et des limites à se fixer qui suscitent de nombreux travaux, que nous analysons dans un deuxième article.
Aller à l'article 2 : Des neurodonnées, personnelles, pas comme les autres…
Illustration : Adobe Stock