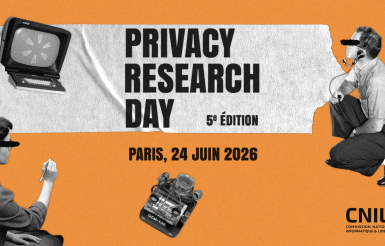Numérique adolescent et vie privée (Épisode 3) : enquête statistique auprès des parents
Rédigé par Mehdi Arfaoui (sociologue) et Jennifer Elbaz (mission EducNum)
-
31 mai 2024Le LINC et le pôle d’éducation au numérique de la CNIL enquêtent sur l'accompagnement à la protection de la vie privée des élèves de collège. Ce troisième épisode s'appuie sur un enquête statistique réalisée auprès de 600 parents d’élèves de collège.

Dans le premier épisode de cette enquête, nous avons montré la place que donnent les travaux en sciences sociales au numérique adolescent, notamment dans la construction des liens avec leurs pairs et dans la formation d’une identité publique. Nous avons vu que les enjeux de surveillance et de contrôle de ces usages sont plus complexes qu'il n'y paraît, et nécessitent d'appréhender adéquatement la place qu'occupent les parents dans la vie d'un adolescent en développement, mais également le rôle joué par l’ensemble de la communauté éducative constituée des enseignants, des médiateurs et des éducateurs vis-à-vis de ces familles.
Dans le deuxième épisode de l’enquête, nous avons mis ces constats à l’épreuve du terrain. 130 entretiens semi-directifs auprès de collégiennes et collégiens nous ont permis de souligner la diversité et la versatilité des usages adolescents du numérique, de mettre en lumière les tensions qu’engendre la multiplicité des sources de contrôle (pairs, famille, école, etc.) autour de ces usages, et de documenter la perception des risques numériques par les adolescents, tout comme les stratégies qu’ils et elles développent pour protéger leur vie privée en ligne.
Ce troisième épisode complète les deux précédents en s’appuyant sur les réponses de 600 parents de collégiennes et collégiens représentatifs de la population française (voir encadré méthodologique et annexes). Les questionnaires portaient sur quatre dimensions : 1) le niveau de compétence numérique que les parents estiment avoir, et en particulier sur la protection des données personnelles, 2) les équipements numériques auxquels leurs enfants ont accès, 3) les pratiques des parents pour accompagner leurs enfants dans leurs usages du numérique, notamment au regard de la protection de leur vie privée, et 4) la perception des risques de violation liés à ces usages. Dans un souci de cumulativité, tout au long de l’épisode, nos résultats sont mis en regard de statistiques produites par d’autres institutions sur la même thématique.
Synthèse de l'épisode 3
- Sans surprise, les inégalités socio-économique et territoriales déterminent fortement le rapport au numérique des parents d’élèves de collège – les répondants des catégories supérieures et habitants des grandes agglomérations étant favorisés par rapport aux autres. Dans le même temps, la répartition des compétences et des pratiques ne se fait pas de façon linéaire – les positions professionnelles intermédiaires ou subalternes de certains parents pouvant par exemple donner un accès à des connaissances liées au RGPD, de même qu’une pratique régulière des réseaux sociaux pouvant orienter des modalités d’accompagnement parental. Toute action de sensibilisation à l’égard des publics doit donc se faire en considérant cette diversité et cette complexité.
- La période de l’arrivée au collège constitue un moment clé de l’acquisition d’un matériel à soi, notamment d’un téléphone portable. Dans l’ensemble, les parents valorisent d’abord le téléphone comme outil de surveillance et de protection de leur enfant (64%). Les inégalités sociales et territoriales semblent toutefois également jouer un rôle dans ce moment clé. Les parents issus des catégories supérieures semblent par exemple être proportionnellement plus nombreux à prendre en compte la composante « sociale » du numérique, tandis que les résidents hors-Paris sont proportionnellement plus nombreux à valoriser la dimension pratique de l’outil notamment en termes de mobilité. Cette diversité des motivations et des modes d’engagement des parents appelle les institutions à mettre en place un accompagnement numérique adapté.
- 92% des parents disent accompagner d’une manière ou d’une autre les activités numériques de leurs enfants. La majorité le fait en discutant avec eux des bonnes façons d’utiliser le numérique, et dans plus d’un cas sur deux jusqu’à l’évocation des questions liées à la protection de la vie privée (59%). Les modalités de contrôle évoluent en fonction de l’âge des enfants, avec des phases d’ajustement du contrôle, notamment en 5e. Les formes de contrôle parental apparaissent également corrélées à la catégorie socio-professionnelle des parents comme au sexe des parents et des enfants. Alors que la 5e semble être un moment charnière dans l’ajustement des pratiques d’accompagnement parental, comment penser le rôle des institutions scolaires et publiques dans ce moment clé ?
- Si 40% des parents interrogés jugent leurs enfants peu ou pas vigilants dans la protection de leur vie privée en ligne, la plupart d’entre eux estime néanmoins qu’il est peu probable voire impossible que leur enfant ait été victime d’attaque ou de vol de leurs données. Cette perception évolue, notamment autour de la 5e, période à la fois de prise en compte du risque et d’apprentissage de l’accompagnement par les parents. Même lorsque l’appréhension des risques est élevée, les parents ne renoncent pas à la mise à disposition d’équipement numérique. Cet épisode nous encouragera donc à réfléchir aux bonnes façons d’accompagner à la fois des parents déjà inquiets mais volontaires pour équiper leurs enfants d’un côté, et des parents moins préoccupés par les risques numériques qu’encourent leurs enfants de l’autre.
Des compétences socialement et géographiquement marquées
Les inégalités socio-économiques et culturelles que nous constatons auprès des parents de collégiens correspondent à celles déjà observées, dans d’autres travaux (Baromètre du numérique 2023 ; ANCT 2022 ; INSEE 2017). À titre d’exemple, lorsque l’on demande aux répondants d’évaluer leur niveau de compétences numériques sur une échelle de 1 à 10, les répondants ayant déclaré appartenir aux cadres et professions intellectuelles supérieures sont proportionnellement plus de trois fois plus nombreux à déclarer des compétences entre 9 et 10 (27%), que les ouvriers (8%). Ainsi, plus on va vers des catégories sociales favorisées, plus les répondants perçoivent leurs compétences comme élevées.
Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre niveau de compétence numérique ? La note de 1 signifiant que vous estimez votre niveau comme étant très faible et 10 comme étant très bon - les notes intermédiaires permettent de nuancer votre évaluation. [Sur la base totale : 605]
Il en va de même pour l’âge, puisque les parents âgés de moins de 35 ans sont 83% à déclarer des compétences allant de 7 à 10 sur 10, là où ils sont 64% chez ceux âgés de plus de 35 ans.
Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre niveau de compétence numérique ? La note de 1 signifiant que vous estimez votre niveau comme étant très faible et 10 comme étant très bon - les notes intermédiaires permettent de nuancer votre évaluation. [Sur la base totale : 605]
Notons que ces différences entre les répondants nous en apprennent presque moins sur le capital numérique objectif des individus (les compétences réelles des individus) que sur la perception qu’ils ont de leurs compétences. Or, la confiance est l’un des éléments clés dans la mise en œuvre de ses compétences (Gaxie, 1978). Des inégalités numériques objectives peuvent ainsi être amplifiées par une inégale confiance des individus vis-à-vis de leurs propres compétences numériques.
Les inégalités sociales se retrouvent également au niveau territorial entre les grandes villes (agglomération parisienne et autres agglomérations de plus de 100 000 habitants) et les villes de taille plus modeste – corroborant les résultats de l’enquêtes TIC-Ménages de l'INSEE selon laquelle « l’absence de capacités est plus fréquente dans les communes rurales dans les unités urbaines de petite taille ou de taille moyenne, qu’en agglomération parisienne » (INSEE 2018). À ce titre, plus la taille d’agglomération des répondants est grande, plus ils et elles déclarent avoir des compétences numériques élevées. Portée par l’agglomération parisienne, la région Ile-de-France est ainsi celle où plus de 21% des répondants déclarent des compétences entre 9 et 10 (sur 10), contre 14% en moyenne sur le reste du territoire. Ce résultat doit être observé en corrélation avec la sociologie particulière du territoire francilien et la répartition des métiers et des diplômes sur le territoire : en effet, les employés du secteur numérique (plus de 50% de cadres)[1] tout comme les jeunes actifs fortement diplômés[2] sont particulièrement concentrés en Île-de-France, et a fortiori dans l’agglomération parisienne.
Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre niveau de compétence numérique ? La note de 1 signifiant que vous estimez votre niveau comme étant très faible et 10 comme étant très bon - les notes intermédiaires permettent de nuancer votre évaluation. [Sur la base totale : 605]
Si ces inégalités sociales et géographiques sont structurantes, elles ne s’appliquent pas tout à fait de la même manière selon qu’on regarde les compétences numériques en général, ou des compétences plus spécifiques. En effet, lorsque l’on interroge les parents de collégiens sur la question plus précise de la protection des données (« Avez-vous déjà entendu parler du RGPD, Règlement européen de protection des données personnelles ? »), les inégalités sociales et géographiques semblent, d’une part, exacerbées pour les ouvriers (dont 40% n’ont « jamais entendu parler du RGPD » contre 2% chez les cadres et professions intellectuelles supérieures) et les résidents des villes de moins de 2 000 habitants (dont 27% n’ont « jamais entendu parler du RGPD », contre 8% en agglomération parisienne). Mais on constate, d’autre part, que des professions intermédiaires, du fait de métiers souvent liés à l’administration, ne sont que 11% à n’avoir « jamais entendu parler du RGPD ». Les positions professionnelles intermédiaires ou subalternes de certains parents peuvent ainsi donner un accès à des connaissances (même si parfois superficielles) liées au RGPD.
De même, de plus faibles compétences numériques perçues ne vont pas forcément avec une moindre utilisation des réseaux sociaux par les parents. À ce titre, lorsque l’on demande au parent « à quelle fréquence vous rendez-vous sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tik Tok, Instagram, X (ex-Twitter), Snapchat, etc.) ? », on retrouve une fréquentation quotidienne proportionnellement plus élevée chez les répondants appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des employés (77%), devant les cadres et professions intellectuelles supérieures (72%), alors que les employés sont proportionnellement plus de deux fois moins nombreux à déclarer des compétences numériques élevées. Dans l’ensemble, les parents restent néanmoins très majoritaires à utiliser les réseaux sociaux : 73% déclarent y aller tous les jours, et 17% plusieurs fois par semaine.
En résumé : Sans surprise, les inégalités socio-économique et territoriales déterminent fortement le rapport au numérique des parents d’élèves de collège – les répondants des catégories supérieures et habitants des grandes agglomérations étant favorisés par rapport aux autres. Dans le même temps, la répartition des compétences et des pratiques ne se fait pas de façon linéaire – les positions professionnelles intermédiaires ou subalternes de certains parents pouvant par exemple donner un accès à des connaissances liées au RGPD, de même qu’une pratique régulière des réseaux sociaux pouvant orienter des modalités d’accompagnement parental. Toute action de sensibilisation à l’égard des publics doit donc se faire en considérant cette diversité et cette complexité.
Un accès socio-géographiquement différencié au matériel
Le pic d’acquisition d’un téléphone par les collégiens se fait à 10-11 ans, c’est-à-dire, à l’entrée en 6e ou juste avant et souvent à l’initiative des parents – un résultat également observé dans d’autres enquêtes (Born Social 2022). Parmi l’ensemble des répondants ayant fourni un téléphone à leur enfant (79%), plus des trois quarts d’entre eux ont ainsi eu un téléphone à 11 ans ou avant. Aussi, parmi les enfants disposant d’un téléphone, plus de 80% disposent d’un forfait internet inclus.
À quel âge votre enfant a-t-il eu un téléphone pour la première fois ? [Sur la base totale : 605]
Si le téléphone intelligent reste le terminal privilégié des enfants (Ipsos Junior Connect’ 2022), une large majorité des parents met également à disposition de leur enfant un ordinateur (84%), et ils sont environ deux tiers à donner un accès à une console connectée (66%), une tablette (65%) et une télévision (64%). L’accès à un ordinateur s’accentue progressivement entre la 6e (77%) à 3e (91%) – comme le note également une enquête sur les pratiques numériques des jeunes en Nouvelle-Aquitaine (Collectif EducPopNum 2024).
Il est intéressant de voir que la catégorie socioprofessionnelle et l’âge des parents semble être corrélés à l’âge auquel les enfants obtiennent un téléphone. Les CSP+ fournissent à leurs enfants un téléphone proportionnellement plus tôt que les CSP- (32% des CSP+ disent en avoir équipé leur enfant avant 11 ans, pour 26% chez les CSP-) ; de même les inactifs et les professions intermédiaires sont proportionnellement plus nombreux à ne pas fournir du tout de téléphone (respectivement 27 et 22%, contre 17% chez les cadres), laissant penser également au rôle joué par les ressources matérielles du foyer dans l’acquisition du premier téléphone, soit que le manque de ressources retarde ou empêche même complètement la fourniture d’un téléphone. Le facteur le plus déterminant semble toutefois être l’âge des parents, puisque les parents ayant moins de 35 ans sont proportionnellement plus nombreux à fournir un téléphone avant la 6e (41% contre 25% chez les plus de 35 ans).
De façon générale, 75% des parents disent avoir équipé leur enfant d’un téléphone portable de leur propre initiative plutôt qu’à la demande de leur enfant, battant en brèche l’idée selon laquelle la plupart des parents cèdent aux requêtes de leurs enfants. Les motivations qui conduisent les parents à équiper leur enfant d’un téléphone sont ainsi en priorité liées à la sécurité et à la surveillance de l’enfant « pour qu'il/elle puisse vous prévenir en cas de problème » (64%), « Parce que cela vous rassure de pouvoir le/la joindre à n'importe quel moment » (48%)[3]. En troisième position, la nécessité de devoir accéder à l’ENT de l’établissement scolaire (« afin qu'il/elle puisse se connecter à l'environnement numérique de travail du collège ») occupe une place également importante (47%). Viennent ensuite les motifs liés à la mobilité – « Parce qu'il/elle doit prendre les transports en commun tout(e) seul(e) » (31%) et « Parce qu'il/elle a des activités extra-scolaires éloignées de votre domicile » (11%) – et celui associé à l’intégration dans le groupe de pair (« Parce que tous ses amis ont un téléphone portable », 10%). Sans oublier les 4% d’autres raisons, parmi lesquelles figurent de nombreux cas de parents divorcés cherchant à poursuivre la communication malgré la garde partagée, ainsi que des situations où un adulte proche (« oncle », « parrain », etc.) a offert un téléphone sans forcément l’aval des parents.
Pour quelles raisons avez-vous fourni un téléphone portable à votre enfant ? [Sur la base des parents ayant fourni un téléphone : 483]
Des inégalités sociales apparaissent alors dans la place accordée à certaines motivations conduisant les parents à équiper les enfants. En effet, les cadres et professions intellectuelles sont proportionnellement plus nombreux que les autres catégories à fournir un téléphone « à la demande de leur enfant » plutôt qu’à leur « propre initiative » (34% contre 24% en moyenne). Cela peut être mis en regard du fait que les CSP+, relativement par rapport aux CSP-, sont proportionnellement plus de deux fois plus nombreux (13% contre 6%) à choisir le motif lié aux sociabilités adolescentes (« parce que tous ses amis ont un téléphone portable »). Une hypothèse consisterait à voir dans quelle mesure des catégories sociales supérieures valorisent, plus que d’autres catégories sociales, la fonction intégratrice du téléphone dans un groupe de collégiens/collégiennes, et ont dans le même temps les compétences numériques et les ressources matérielles pour y répondre. Si l’on sait que le numérique est un atout dans la constitution d’un capital social (M@rsouin 2017), les parents de catégories plus privilégiées semblent matériellement et culturellement mieux dotées pour équiper leurs enfants en ce sens.
Enfin, on voit que les répondants de l’agglomération parisienne sont proportionnellement moins nombreux à indiquer comme motif d’acquisition d’un téléphone le fait que leur enfant doivent « prendre les transports en commun tout(e) seul(e) » (19% contre 31% en moyenne), renvoyant sans doute à l’éloignement bien plus faible des collèges et des lieux d’activité en agglomération parisienne que sur le reste du territoire en moyenne, et à l’accessibilité des transports dans cette agglomération (DEPP 2019).
En résumé : La période de l’arrivée au collège constitue un moment clé de l’acquisition d’un matériel à soi, notamment d’un téléphone portable. Dans l’ensemble, les parents valorisent d’abord le téléphone comme outil de surveillance et de protection de leur enfant (64%). Les inégalités sociales et territoriales semblent toutefois également jouer un rôle dans ce moment clé. Les parents issus des catégories supérieures semblent par exemple être proportionnellement plus nombreux à prendre en compte la composante « sociale » du numérique, tandis que les résidents hors-Paris sont proportionnellement plus nombreux à valoriser la dimension pratique de l’outil notamment en termes de mobilité. Cette diversité des motivations et des modes d’engagement des parents appelle les institutions à mettre en place un accompagnement numérique adapté.
Des formes d’accompagnement dynamiques et également différenciées
Parmi l’ensemble des répondants, 92% indiquent discuter des bonnes façons d'utiliser les outils numériques avec leurs enfants au moins une fois par mois. Parmi ces échanges, 59% des parents disent systématiquement (7%) ou régulièrement (52%) parler en particulier de la protection de leurs données personnelles et leur vie privée sur internet.
À quelle fréquence discutez-vous, accompagnez-vous votre enfant aux bonnes façons d'utiliser les outils numériques (internet, smartphone, ordinateurs) et à leurs risques ? [Sur la base totale : 605]
On observe d’ailleurs, parmi les parents qui évoquent la protection des données personnelles avec leurs enfants, 15 points d’écart entre les parents qui ont entendu parler du RGPD et voient « bien de quoi il s’agit » et ceux qui en ont entendu parler, mais ne voient « pas bien de quoi il s’agit ». On peut donc noter l’importance du sentiment de maîtrise de ces sujets dans la propension des parents à vouloir et pouvoir les évoquer avec leur enfant.
Parmi ces échanges, vous arrive-t-il de parler en particulier de la protection de leurs données personnelles et leur vie privée sur internet ? [Sur la base totale : 605]
Concernant les formes de surveillance employés, la grande majorité des répondants dit contrôler les activités numériques (86%), soit par le biais d’outils de contrôle parental (59%)[4], soit en ayant directement accès au téléphone de leur enfant (55%). Pour le reste, 4% affirment que leurs enfants n’ont pas d’activités numériques, tandis que 10% affirment ne pas les contrôler, en particulier pour les parents d’élèves de 3e. À ce titre, on note que si le niveau de contrôle est le plus bas en 3e (76% contre 87% en 6e), la proportion de parents affirmant contrôler les activités numériques de leurs enfants n’évoluent pas de façon linéaire de la 6e à la 3e. En écho aux formes d’appropriations dynamiques du numérique observées dans l’épisode 2, on observe chez les enfants équipés d’un téléphone un ajustement de l’accompagnement après la 6e avec un contrôle parental plus fort en 5e par rapport à la 6e, notamment sur la limitation du temps d’écran (75% en 5e contre 63% en 6e) ou encore sur l’autorisation par notification lors d'actions sensibles comme l’installation d'application ou le paiement (72% en 5e contre 62% en 6e). Tout se passe ainsi comme si l’appropriation dynamique du numérique engendrait des phases d’ajustement de l’accompagnement parental pour répondre aux écarts entre les pratiques prévues par les parents et les pratiques effectives de leurs enfants.
Ici encore, on observe des inégalités sociales notables dans les modalités d’accompagnement parental, nous permettant de corroborer certains des résultats de l’épisode 2 de cette enquête. On constate notamment que les CSP- sont proportionnellement plus nombreux à intervenir directement sur le téléphone de leurs enfants (plutôt que via un outil à distance) pour exercer un contrôle (61% contre 50% chez les CSP+). Proportionnellement aux cadres et professions intellectuelles supérieurs, les employés sont ainsi près de 20% plus nombreux à opter pour ces formes d’intervention direct (65% contre 46% chez les cadres et professions intellectuelles supérieurs).
Il est intéressant de rappeler, comme énoncé plus haut, que tout en faisant partie des répondants déclarant de faibles compétences numériques, la catégorie des employés est celle qui déclare une utilisation des réseaux sociaux la plus quotidienne. Une hypothèse consisterait à voir dans quelle mesure certains répondants compensent de faibles capabilités numériques avec une connaissance pratique des réseaux sociaux leur permettant d’intervenir directement sur les dispositifs numériques de leurs enfants. À l’inverse, il semble que les CSP+, du fait de capabilités numériques plus fortes, sont proportionnellement plus nombreux à employer les outils de contrôle parental en général (Baromètre du numérique 2023), mais également à faire usage de la diversité des outils de contrôle parental, à travers notamment des méthodes plus indirectes de contrôle comme le filtrage de certains contenus et la configuration de rapports hebdomadaires ou mensuels automatiques résumant les activités de leurs enfants.
On constate de même que les personnes vivant en agglomération parisienne, et plus généralement en Ile-de-France, disposent davantage de personnes ressources dans leur entourage (amis ou famille) pour les aider dans l'éducation au numérique de leur enfant (42% en agglomération parisienne, contre 30% en moyenne). C'est encore plus vrai chez les mineurs de 12 à 17 ans, qui sont proportionnellement plus de deux fois plus nombreux que le reste de la population à déclarer les amis ou la famille comme principale source de conseil à cet égard (voir ci-dessous, Baromètre du numérique 2023). Alors qu’à ce jour le cercle proche constitue (avec l’auto-information sur internet) la principale source d’information des français pour se protéger en ligne, ces inégalités en capital social appellent à un véritable renforcement du travail de sensibilisation de la CNIL et de l’éducation au numérique en général.
Les formes d’accompagnement apparaissent également genrées, autant du côté des parents que des enfants. Ainsi, les mères semblent recourir en moyenne plus souvent à l’intervention directe sur le téléphone que les pères (59% contre 50%). Cela peut être mis en lien avec la plus forte connaissance pratique des réseaux sociaux chez les mères relativement aux pères (les mères sont 79% à déclarer aller tous les jours sur les réseaux sociaux, contre 65% pour les pères), mais également au rôle souvent dévolu aux femmes dans la prise en charge des tâches éducatives et scolaires au sein de nombreux foyers (Brugeilles et Sebille 2009). D’ailleurs, les réponses à notre questionnaire montrent que les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à désigner « l’autre parent » comme celui avec lequel que l’enfant « passe le plus de temps à parler de ses usages numériques » (17% des pères désigne « l’autre parent », contre 11% pour les mères). L’enquête ELFE (2022) montrait à ce titre que « les deux parents ont parfois une influence différenciée : une durée d’utilisation [d’écran] plus élevée de la mère augmente la probabilité d’une trajectoire de découverte [des écrans] […], quand la durée d’utilisation du père n’a pas d’impact significatif sur les trajectoires de découverte ». De même, les filles font plus souvent l’objet d’interventions directes que les garçon (59% contre 52%), ce qui peut également être mis en lien avec le fait que la charge de l’accompagnement, notamment concernant des choses intimes, se fait elle-même de façon sexuée : les mères accompagnant plus souvent les filles, et les pères accompagnant plus souvent les garçons (Brugeilles et Sebille 2009)[5]. Enfin, comme le montre une enquête de l’Observatoire de Normandie auprès de plus de 3 500 adolescents, les jeunes filles se disent elles-mêmes davantage inquiètes des risques qu’elles encourent en ligne (harcèlement, propos ou images violents et insultes, menaces), ce qui est susceptible de renforcer la demande d’accompagnement de leur part (Jehel 2021).
En résumé : La plupart des parents disent accompagner d’une manière ou d’une autre les activités numériques de leurs enfants. La majorité en discutant avec eux des bonnes façons d’utiliser le numérique, et dans plus d’un cas sur deux jusqu’à l’évocation des questions liées à la protection de la vie privée. Les modalités d’accompagnement évoluent en fonction de l’âge des enfants, avec des phases d’ajustement du contrôle, notamment en 5e. Les formes de contrôle parental apparaissent également corrélées à la catégorie socio-professionnelle des parents comme au sexe des parents et des enfants. Alors que la 5e semble être un moment charnière dans l’ajustement des pratiques d’accompagnement parental, comment penser le rôle des institutions scolaires et publiques dans ce moment clé, tout en s'efforçant de compenser les inégalités sociales ?
Un rapport pragmatique aux risques de violation
Près de 60% des parents estiment que leurs enfants sont vigilants (7 ou 8/10 à 41%) ou très vigilants (9 ou 10/10 à 19%) dans la protection de leurs données personnelles, ce qui laisse 40% de parents évaluant comme faible ou moyen le niveau de vigilance de leur enfant. Plusieurs enquêtes montrent en effet qu’environ la moitié des adolescents déclarent appliquer les bonnes pratiques de protection de la vie privée (désactivation de la géolocalisation, mot de passe robuste, profil anonyme, etc.) (Collectif EducPopNum 2024 ; Génération numérique 2022). Dans le même temps, une grande majorité des parents (87%) est d’avis qu’il est peu probable (69%) voire impossible (18%) que leurs enfants aient été victime de violation de leurs données personnelles, tandis que 10% des parents pensent que c’est probable, voire certain (2%).
Diriez-vous, votre enfant a déjà subi une violation de ses données personnelles en ligne ? [Sur la base totale : 605]
L’UNAF montre à ce titre dans son enquête "Parents, Enfants & Numérique" que les parents ont tendance à sous-estimer les risques réels auxquels leurs enfants ont déjà été exposés (UNAF 2022). Cela peut être expliqué par le fait que les parents n’ont finalement accès qu’à une partie des activités numériques de leurs enfants. En 2020, 82 % des enfants de 10 à 14 ans indiquaient aller régulièrement sur Internet sans leurs parents, nous permettant de continuer à affirmer que « les parents […] mesurent de plus en plus mal l’ampleur de leurs activités numériques au fur et à mesure que les années passent » (CNIL 2020).
La vigilance estimée et la probabilité perçue d’une violation par les parents évoluent toutefois selon la classe de l’enfant : alors que les parents d’enfant de 6e ne sont que 7% à penser qu’il est probable ou certain que leur enfant ait subi une violation, ce chiffre passe à 16% en 5e. Cela dénote probablement, comme souligné plus haut, d’une prise de conscience des risques auxquels sont exposés leurs enfants. La 5e est d’ailleurs le niveau auquel les parents sont proportionnellement plus nombreux à déclarer aller chercher des informations sur internet ou auprès d’autorités publiques pour s’aider dans l’éducation au numérique de leur enfant. La probabilité perçue du risque de violation diminue ensuite jusqu’à la 3e mais reste toujours plus élevé que pour les enfants de 6e. Les parents sont ainsi de moins en moins nombreux à penser qu’il est impossible que leur enfant ait été victime de violation (on passe de 25% de parents qui pensent que c’est impossible en 6e, à 12% en 3e), tout en étant proportionnellement plus nombreux à penser que c’est peu probable (on passe de 64% de parents en 5e, à 75% des parents en 3e qui pensent que c’est peu probable). Cela suggère, en parallèle de la prise de conscience des risques, une phase d’apaisement et de reconnaissance par les parents du processus d’appropriation numérique de leur enfant évoqué dans l’épisode 2.
De fait, les parents ayant des compétences numériques perçues élevées et une bonne connaissance du RGPD (notamment les cadres et professions intellectuelles supérieurs, les habitants de grandes agglomérations et les jeunes parents) sont également ceux qui vont juger proportionnellement plus probable une violation des données personnelles de leur enfant.
Proportion de parents jugeant « Probable » une violation des données personnelles de leur enfant. [Sur la base totale : 605]
On trouve ainsi proportionnellement deux fois plus de parents ayant de fortes compétences perçues parmi les répondants jugeant probable ou certaine une violation (26%), que parmi ceux qui la jugent peu probable ou impossible (12%). De même, 57% des parents considérant une violation probable ou certaine disent avoir une bonne connaissance du RGPD, tandis qu’ils ne sont que 43% chez les parents jugeant une violation improbable ou impossible. On peut, en ce sens, parler d’un rapport pragmatique au numérique : l’appréhension des risques numériques n’empêche pas la mise à disposition d’équipement numérique et le travail d’appropriation. Le risque de violation semble devenir un facteur à prendre en compte dans le processus d’apprentissage, ce qui engendre à la fois des inquiétudes et des frustrations. Comme le rappelle l’UNAF, plus de la moitié (56%) des parents estiment qu’Internet est à la fois un risque et une opportunité pour leurs enfants (UNAF 2022).
Les répondants de l’agglomération parisienne en particulier semblent constituer un cas de figure paradigmatique des tensions produites dans cette relation pragmatique aux numériques de leurs enfants : ces parents font partie de ceux disposant des plus importantes ressources sociales, économiques et culturelles, et sont ceux qui vont équiper le plus tôt leurs enfants d’un téléphone ; ils et elles jugent très positivement le niveau de vigilance numérique de leur enfant (les parents de l’agglomération parisienne sont 28% à déclarer leurs enfants vigilant à 9 ou 10/10, contre 19% en moyenne) et leur parlent régulièrement de la protection de leur données personnelles (86% contre 69% en moyenne) ; dans le même temps, ils et elles déclarent plus probable une violation des données de leurs enfants (17% contre 10% en moyenne) et sont proportionnellement plus nombreux à vouloir passer moins de temps à surveiller et contrôler leurs enfants (28% contre 15% en moyenne).
En résumé : Si 40% des parents interrogés jugent leurs enfants peu ou pas vigilants dans la protection de leur vie privée en ligne, la plupart d’entre eux estime néanmoins qu’il est peu probable voire impossible que leur enfant ait été victime d’attaque ou de vol de leurs données. Cette perception évolue, notamment autour de la 5e, période à la fois de prise en compte du risque et d’apprentissage de l’accompagnement par les parents. Même lorsque l’appréhension des risques est élevée, les parents ne renoncent pas à la mise à disposition d’équipement numérique, nécessitant un inéluctable travail d’appropriation des outils par les enfants et d’apprentissage de l’accompagnement par les parents. Cet épisode nous encourage donc à réfléchir aux bonnes façons d’accompagner à la fois des parents déjà inquiets mais volontaires pour équiper leurs enfants d’un côté, et des parents moins préoccupés par les risques numériques qu’encourent leurs enfants de l’autre. De même, alors qu’une faible proportion des sondés (9%) disent se tourner vers une autorité compétente comme la CNIL en cas de problème (contre 31% qui se tourneraient vers la police/gendarmerie, et 20% vers les amis et la famille – Baromètre du numérique 2023), comment s’assurer de proposer des points de contact visibles et de délivrer un message clair aux familles et aux citoyens en général ?
[1] « En 2016, près d’un actif francilien sur dix travaille dans le secteur numérique, soit trois fois plus qu’en province. » (INSEE 2019)
[2] « Les jeunes actifs vivant dans la métropole du Grand Paris sont plus souvent diplômés de l’enseignement supérieur (61 %) que dans les autres métropoles françaises (48 %). […] En lien avec leurs hauts niveaux de diplôme, les jeunes actifs de la métropole du Grand Paris occupent plus souvent des emplois de cadre que ceux des autres grandes métropoles de province : respectivement 30 % et 14 %. » (INSEE 2022)
[3] Cette préoccupation fait écho aux résultats de l’enquête Parents, Enfants & Numérique de l’UNAF, selon laquelle 41% des parents ont déjà utilisé un logiciel d’espionnage dont 30 % en concertation avec leur enfant (UNAF 2022).
[4] Un chiffre beaucoup plus élevé que de l’enquête du CSA pour Bouygues Telecom en 2018, selon laquelle « 19% des parents ont installé un contrôle parental » (CSA 2018).
[5] Comme le révèle cette enquête Erfi-GGS, « les pères sont particulièrement en retrait dans les moments les plus intimes tels que l’habillage et le coucher de leur fille, […] il en est de même pour les loisirs, moments privilégiés de transmission de pratiques et de goûts sexués ».