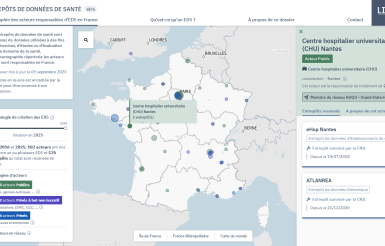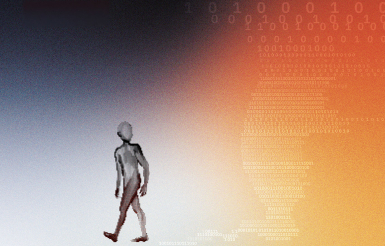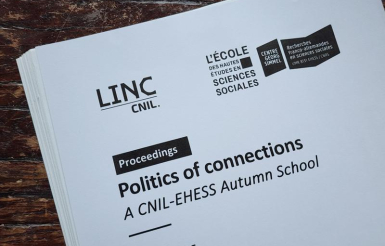Enquête : les Français et les données post mortem
Rédigé par Martin Biéri
-
15 octobre 2025En fin d’année 2024 et dans le cadre des travaux de rédaction du Cahier IP n°10 « Nos données après nous », le LINC a lancé une enquête avec Harris Interactive – Toluna afin d’explorer les relations des Français aux données post-mortem.

Cette enquête a été réalisée en ligne du 20 au 26 novembre 2024 auprès d’un échantillon de 2 112 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas appliquée au sexe, à l’âge, à la catégorie socio-professionnelle, à la région et à la taille d’agglomération d’habitation. Elle avait pour but d’explorer leur rapport à la perte de contenus numériques, à l’exposition à des « contenus post mortem » en ligne. De manière plus prospective, elle abordait les perspectives d’immortalité numérique, à travers des systèmes d’IA (comme les deadbots, des agents conversationnels entraînés sur les données de personnes décédées).
Perdre du contenu numérique, une expérience commune et face à laquelle les Français ont connaissance de solutions
La première partie de l’enquête visait la question de l’usage du numérique et du rapport à la perte de contenus. Ainsi, 81% de l'échantillon affirme avoir déjà perdu du contenu numérique (dont 8% fréquemment). C’est en particulier le cas des plus jeunes (88% pour les 15 – 24 ans ; 90% pour les 25 – 34 ans), qui sont aussi ceux qui disent bien maîtriser les outils numériques et utiliser fréquemment les réseaux sociaux. Il pourrait être fait ici l’hypothèse que plus les utilisateurs produisent du contenu, plus ils sont susceptibles d'en perdre – mais aussi que plus leur production en ligne est importante, plus l'attachement aux contenus est fort, et donc la perte vécue comme problématique.
Pour pallier ces pertes, les supports physiques sont les plus mobilisés : le stockage sur un support USB externe (une clé) reste majoritaire, devant le stockage sur un disque dur externe. La maîtrise des outils numériques est toutefois un facteur déterminant dans le choix des supports de stockage mobilisés. A titre d’exemple, la mobilisation du stockage sur le cloud (hébergement sur des serveurs à distance) est la solution pour laquelle on constate le plus gros écart entre ceux qui déclarent mieux maitriser les outils numériques (45% mobilisent le cloud) et ceux ne les maitrisent pas ou peu (17%). L'impression papier fait montre d’une popularité transversale (environ 50% des interrogé-e-s) et est le moyen pour lequel on constate l'écart le plus faible entre les personnes qui considèrent maitriser le numérique et les autres (53% contre 42%). Si les solutions « immatérielles » (en ligne) sont moins plébiscitées, il est possible que ce soit notamment parce qu’elles sont moins largement connues et moins maîtrisées, quand bien même elles sont de plus en plus intégrées à des offres grand public (via les smartphones, les ordinateurs personnels, etc.).
Concernant la fonctionnalité « souvenir photographique », proposée des grandes plateformes de services numériques, le sondage montre que les trois quarts des répondants la trouvent intéressante – notamment pour se remémorer des événements passés, mais également pour envoyer des souvenirs aux proches et, dans une moindre mesure, pour retrouver des photos de proches décédés. Ici encore, les motivations à utiliser ces fonctions, différenciées selon l’âge (remémoration personnelle chez les plus âgés, partage chez les plus jeunes), montrent que ces outils s’inscrivent dans la valorisation d’une mémoire continue.
- Voir Des stratégies différenciées de conservation des données dans le Cahier IP (page 41) pour aller plus loin.
L’existence post mortem de contenus publiés en ligne, une perspective qui divise et qui effraie
Près d’un tiers (31%) de la population répondante indique avoir été confronté à des contenus sur les réseaux sociaux émanant d’un compte d’une personne décédée (17% indiquent que cela est déjà arrivé plusieurs fois). 29% affirment ainsi avoir reçu des notifications automatiques émanant du compte d’une personne décédée, tandis que 28% indiquent avoir déjà interagi (partage, « j’aime », mise en favori, etc.) avec un contenu d’une personne décédée. Ces expériences sont bien davantage vécues par les plus jeunes, plus actifs sur les réseaux sociaux : 52% des 18 – 24 ans, et 56% des 25 – 34 ans disent avoir été confrontés à ce type de situation.
Lorsque l’on se penche sur la gestion des comptes, 30% des personnes interrogées indiquent avoir interagi depuis le compte d’une personne décédée. Pour 16% d’entre elles, la principale action a été d’enregistrer les photos et les vidéos pour les conserver. Pour 11%, il s’est agi de gérer la fermeture des comptes ; pour 9% de faire un tri sur les contenus en ligne et, enfin, dans la même proportion (9%), de poster un contenu (message ou photo) depuis le compte du proche décédé.
Concernant le souhait des personnes quant à leur propre contenu après leur décès, 78% des personnes indiquent souhaiter qu’une partie des contenus postés ne soient plus visibles après leur mort (52% voudraient que rien ne reste du tout et 26% a minima triés). Le souhait que le contenu ne soit plus du tout visible est plus fort chez les femmes (57%, soit 10 points de plus que chez les hommes, à 47%), et les personnes plus âgées (66%, soit 14 points au-dessus de la moyenne). A l'inverse, on voit que les usagers des réseaux sociaux, les technophiles en général (maîtrise de l’environnement numérique, connaissance du RGPD, etc.) sont plus nombreux à préférer garder la visibilité des contenus ou les trier, plutôt que de les voir disparaître – ce qui pourrait faire écho avec le point développé plus haut : plus l’on produit en ligne, plus l’attachement à ces contenus serait fort et donc la volonté de les conserver accrue. De la même manière, une autre l’hypothèse pourrait être que celles et ceux qui maîtrisent le mieux les outils font déjà un tri régulier ou choisissent a priori ce qu’ils veulent laisser en ligne.
Pour la suppression ou le tri, la moitié des personnes interrogées estime que cela pourrait être la responsabilité des proches ou des descendants de s’en occuper – 14% confierait la tâche à un tiers de confiance, 13% à la plateforme qui hébergent les contenus. Dans le même temps, 22% des personnes disent préférer s’en occuper elles-mêmes, en anticipation de leur décès.
- Voir Une préférence pour la suppression, Des écarts générationnels et de genre et Des réticences à la configuration ante mortem dans le Cahier IP (pages 15 et 16) pour aller plus loin.
L’immortalité à travers l’IA, une perspective qui divise tout en attisant la curiosité d’une partie des Français
Cette dernière partie de l’enquête visait spécifiquement les outils récents, fondés sur des systèmes d’intelligence artificielle permettant de répliquer les comportements de personnes défuntes (sous forme de chatbot, par exemple, en se basant sur les données numériques dont elle dispose sur cette personne (photos, vidéos, enregistrements, écrits, etc.)).
Dans ce cadre, une minorité des répondants – sans pour autant être marginale – semblent encline à continuer à échanger avec des proches décédés : seulement 8% indiquent qu’ils accepteraient « certainement » l’idée qu’eux-mêmes ou leurs proches alimentent un système d’intelligence artificielle avec leurs données pour que cette dernière leur « survive », tandis que 20% accepteraient « probablement ». Les répondants sont proportionnellement moins nombreux encore à accepter l’idée d’échanger eux-mêmes avec une intelligence artificielle de ce type pour rester en contact avec leurs proches (7% accepteraient certainement, et 16% probablement).
La majeure partie des répondants semble donc plutôt mettre à distance l’utilisation de ces systèmes : ils sont ainsi 72% à refuser d’alimenter une IA, que ce soit de leur fait ou celui de leur proche (47% refuseraient de façon certaine). Pis encore, ils sont 77% à refuser l’idée d’échanger eux-mêmes avec une IA de ce type pour rester en contact avec leurs proches (dont 52% de façon certaine).
Comme pour les points précédents, la question de l’âge et du genre semble jouer un rôle. En effet, si un quart des répondants affirme accepter l’idée d’utiliser une IA pour continuer à échanger avec leurs proches, il faut noter certaines disparités : 41% des 25-34 ans y seraient favorables, contre seulement 8% des 65 ans et plus. De la même manière, il y a 13% d’écart entre les hommes et les femmes, les premiers étant les plus enclins à avoir recours à ce type d’IA (quel que soit le scénario présenté). Enfin, il est intéressant de noter que le fait d’être parent d’enfant encore à domicile semble renforcer l’acceptation de ce type d’IA : 37% des répondants qui sont dans cette situation accepteraient d’alimenter une IA de leur vivant pour leurs proches, contre 21% pour les répondants sans enfants à domicile.
Si dans un premier temps, le rejet est majoritaire, les résultats tendent à montrer que les pratiques ne semblent pas figées, l’acceptation de ces systèmes étant corrélée positivement avec l’utilisation des réseaux sociaux et avec le fait d’avoir été en contact avec des contenus post mortem.
- Voir Une perspective qui divise tout en montrant des marges d’habituation dans le Cahier IP (page 34) pour aller plus loin.